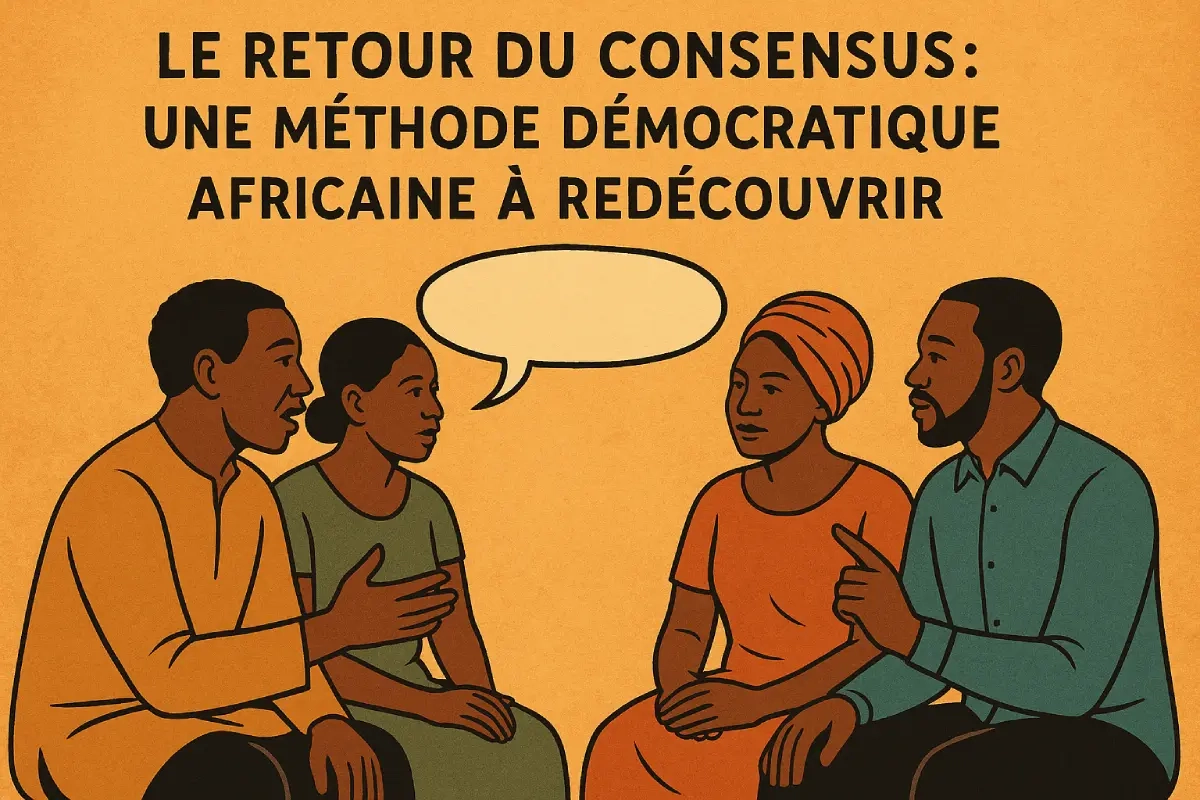Depuis quelques semaines, la dynamique politique au Bénin remet en lumière une méthode démocratique longtemps oubliée : le consensus. Lorsqu’on évoque la démocratie, la plupart des esprits se tournent vers le vote, comme s’il en était l’unique expression. Pourtant, le consensus est l’une des formes les plus anciennes de délibération démocratique, ancrée dans les traditions africaines.
Entre 2021 et 2024, j’ai participé au développement d’un programme d’évaluation des talents axé sur la capacité de collaboration. L’un des exercices consistait à laisser les participants s’auto-organiser pour prendre une décision, sans aucune règle imposée. Sur plus de trente équipes observées, j’ai remarqué un phénomène constant : les groupes commencent par chercher le consensus, mais dès que la réflexion devient exigeante et que le temps presse, ils basculent rapidement vers , jugé plus simple et rapide.
Pourtant, ce choix « efficace » peut parfois faire passer à côté d’une solution plus juste ou plus profonde, qu’un échange prolongé aurait permis de révéler.
Coup d’Etat raté au Bénin : la tête de Pascal Tigri mise à prix
Bénin : les conseils de Lionel Zinsou pour améliorer le pouvoir d’achat alimentaire
La désignation du duo de la mouvance présidentielle pour les prochaines élections au Bénin, issue d’un long processus de consensus, illustre cette démarche. Derrière ce choix, on imagine des heures de discussions et de réflexions pour parvenir à une décision équilibrée, capable de maintenir la cohésion du groupe et la continuité de son plan d’action.
L’agriculture au Bénin, un secteur stratégique en pleine reconfiguration
Bénin : voici l’équipe de campagne de Romuald Wadagni
Dans les cultures africaines traditionnelles, le consensus a longtemps été le cœur du processus décisionnel. Sous l’arbre à palabres, les membres de la communauté discutaient jusqu’à atteindre un équilibre, une entente autour de laquelle chacun pouvait se rallier non par contrainte, mais par conviction.
Redécouvrir cette méthode aujourd’hui, c’est peut-être renouer avec une démocratie plus humaine, inclusive et durable, où la parole ne se compte pas, mais se construit ensemble.
Kafid TOKO, Facilitateur en intelligence collective